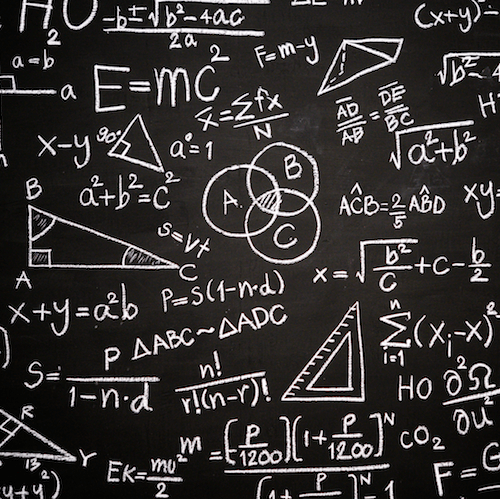L’idée de recourir à la création monétaire pour financer les investissements nécessaires à la transition écologique se heurte à plusieurs croyances économiques. Certaines sont relatives au rôle de la monnaie. Nous avons tenté de les décrypter dans l’article Créer de la monnaie pour surmonter la crise environnementale. D’autres, relèvent de l’idée reçue courante chez les macroéconomistes selon laquelle ces investissements ne seraient pas prioritaires car ils ne contribueraient pas à l’amélioration de la productivité, considérée comme la principale source de croissance économique. Au contraire, ils auraient même un impact négatif car ils alourdiraient la dette publique. Cet article vise à remettre en cause cette idée reçue.
1/ Croissance et productivité : le discours économique.
Selon la majorité des économistes, la croissance économique (celle du PIB par habitant) d’un pays résulte de celle de la productivité des facteurs de production[1], due aux progrès scientifiques et techniques et à ceux de l’organisation du travail. A leurs yeux, les dépenses publiques à réaliser dans un pays ne devraient être que des dépenses dites « productives », où contribuant à cette croissance de la productivité[2].
Pourquoi privilégier les dépenses « productives » ?
L’idée s’explique simplement : supposons que l’économie soit au « plein emploi » des capacités productives (toutes les personnes qui souhaitent travailler ont un emploi ; dans les usines, les machines tournent à plein régime). Le PIB ne peut pas croitre plus vite que la croissance démographique sans gain de productivité.
La notion de « croissance potentielle » est liée à ce raisonnement : si le plein emploi n’est pas atteint, il y a une « réserve » de croissance ou un « écart de croissance » entre la croissance mesurée et la croissance « potentielle », (en anglais « output gap »). Cet écart peut être comblé mais en levant les freins et les rigidités qui sont supposés, dans cette vision, s’opposer à ce plein emploi (comme par exemple un SMIC trop élevé, ou des conditions trop généreuses d’aides aux chômeurs). Quant au « plein emploi » précisons qu’il ne correspond pas à un taux de chômage nul ou à un taux d’emploi de 100%, car du fait de frictions diverses, il y a un taux de chômage minimal[3] sous lequel il n’est pas possible de passer en pratique, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas toujours possible de passer instantanément d’un emploi à un autre.
Dans cette vision de l’économie, la croissance économique de moyen – long terme (toujours considéré comme un objectif central de la politique économique) résulte uniquement de ces gains de productivité.
Les dépenses publiques « improductives » n’auraient aucun effet sur l’activité économique
Cela veut dire a contrario que dans une économie en sous-emploi, un gouvernement qui mettrait au travail ces chômeurs[4] en mobilisant l’argent public pour des dépenses considérées par les économistes comme « improductives » (par exemple des travaux d’intérêt général) n’engendrerait qu’un feu de paille en termes de croissance : ces dépenses ne pourraient que creuser le déficit et la dette publics, se traduisant à terme par de l’inflation ; elles finiraient par alourdir les prélèvements obligatoires[5] et affaibliraient la compétitivité de l’économie. Seules des dépenses productives, relevant le niveau de la croissance potentielle, seraient bénéfiques. Notons que ce raisonnement s’applique aussi en creux au temps de travail : la baisse du temps de travail ne pourrait être bénéfique à l’économie que si elle se traduisait par des gains de productivité du travail.
Comment savoir qu’une dépense ou un investissement est productif ?
Il doit être « rentable [6]». Dans le secteur privé le calcul financier permet d’objectiver la notion. Un investissement est rentable pour une entreprise si son rendement financier est supérieur au coût pondéré du capital (WACC) ou si sa Valeur Actualisée Nette (calculée avec un taux d’actualisation égal au WACC ) est positive ou nulle[7].
Dans le cas des investissements publics cette rentabilité résulte d’un calcul socio-économique qui aboutit lui aussi à une VAN (voir la fiche sur le taux d’actualisation (partie 2) de la plateforme The Other Economy). En pratique néanmoins, le ministère des finances tient compte aussi du retour financier car un investissement public dont la VAN est positive ou nulle peut avoir un rendement financier négatif et peser sur le déficit et la dette publics. Le ministère des finances peut être encore plus restrictif (et ça va être le cas dans les prochaines années en France si la trajectoire budgétaire est respectée) et s’opposer même à des investissements rentables à moyen terme, s’ils pèsent trop à court terme sur le déficit[8]…
2/ La croissance du PIB ne dépend pas que de la productivité des facteurs de production.
Comme nous allons maintenant le voir, la croissance du PIB, dont nous ne discuterons pas ici de la pertinence en tant qu’indicateur de « bien-être social »[9], n’est pas toujours due à la productivité des facteurs de production qui, inversement, peut ne pas générer de croissance.
2.1 La productivité des facteurs de production peut ne pas se traduire en croissance économique.
La mécanisation et plus généralement le progrès technique (automatisation, informatisation, robotisation) ont deux effets immédiats, toutes choses égales par ailleurs :
- ils suppriment des emplois,
- ils réduisent la part des salaires dans la production.
Ce n’est pas pour rien qu’ils ont toujours suscité[10] l’angoisse de la destruction d’emplois et de l’augmentation du chômage. Mais l’histoire a aussi montré que les choses ne sont pas « égales par ailleurs ».
i/ Les gains de productivité ont été en partie partagés (entre les patrons et les salariés, et grâce aux combats des salariés et de leurs représentants) et du coup ont généré une croissance du pouvoir d’achat. Mais cette répartition n’est pas une loi naturelle[11] et peut se déformer fortement en défaveur des salariés (c’est ce qu’on constate dans les vingt dernières années en Europe[12] ).
ii/ Les entreprises ont inventé des nouveaux produits et services permettant à ce pouvoir d’achat de se transformer en consommation et créant de nouveaux emplois. C’est ainsi que la part de la population active occupée dans l’agriculture s’est réduite massivement dans les pays « développés » et que nombre de « petits métiers » ont disparu, remplacé par des machines, tandis que nombre de nouveaux secteurs et métiers sont apparus. C’est ce qu’Alfred Sauvy a nommé le « déversement[13] ».
iii/ La durée effective du travail par actif a considérablement été réduite aux XIX e et XX e siècles.
Mais ces trois mécanismes ne sont pas automatiques.
Dès lors, il se peut que les gains de productivité ne se traduisent pas en « déversement » et ne s’accompagnent pas de croissance du PIB. Citons les économistes Daron Acemoglu[14] et Simon Johnson, qui ont approfondi ce sujet : « Contrairement à la croyance populaire, la croissance de la productivité ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la demande de main d’œuvre. (…) Au cours des quatre dernières décennies, l’automatisation a augmenté la productivité et multiplié les bénéfices des entreprises, mais elle n’a pas conduit à une prospérité partagée dans les pays industrialisés. »[15]
2.2 La croissance s’explique par d’autres facteurs que la productivité des facteurs de production.
Il n’y a en fait pas de théorie unifiée explicative de la croissance économique. Nous allons nous limiter ici à quelques faits.
-Pendant des siècles et dans de nombreux pays, il n’y a pas eu de croissance du PIB (ou assimilée dans le cas où le PIB n’était pas formellement établi par l’appareil de statistiques publiques). Elle suppose là où elle est observée, la réalisation de nombreuses conditions sur de nombreux registres : scientifique, technologique, éducatif, culturel, juridique, social, institutionnel et politique, mais aussi en termes d’infrastructures et bien sûr en termes d’accès aux ressources naturelles au premier rang desquelles l’énergie.
-Elle suppose donc de fait beaucoup de dépenses « improductives » (les dépenses publiques courantes dans l’éducation, la santé, la sécurité…) et aussi des transferts sociaux qui le sont tout autant.
-La croissance du PIB peut résulter de destructions du capital naturel ou du capital artificiel comme on l’observe dans les périodes de reconstruction après des guerres, des séismes ou autres catastrophes naturelles. Elle s’accompagne par ailleurs aujourd’hui très généralement de prélèvements détruisant le capital naturel.
-Elle peut s’observer dans une économie de guerre, particulièrement improductive dans tous les sens du terme : les armes et le matériel militaire ne sont évidemment pas facturés aux ennemis contre lesquels ils sont utilisés ; et ils détruisent des humains, du capital productif et des ressources naturelles. Ces destructions de capital sont en outre autant d’opportunités d’activités en sortie de conflits.
3/ Des dépenses dites « improductives » doivent être financées, en particulier pour limiter l’ampleur et les impacts du changement climatique et de la destruction du vivant.
Nous vivons un tournant dans l’histoire économique et sommes face à une véritable bifurcation. Si nous n’investissons pas pour transformer nos économies de sorte qu’elles soient sobres, bas-carbone et résilientes au changement climatique, nous connaîtrons des catastrophes, des désordres politiques et des désastres humanitaires, des conflits sociaux et des guerres. Les causes en sont le changement climatique, la destruction des ressources naturelles dont nous dépendons pour nous nourrir et plus généralement pour toute notre vie économique, notre dépendance aux énergies carbonées et la détérioration croissante de notre balance commerciale. Tous ces effets ne laissent présager rien d’autres que la décroissance généralisée (à de nombreux pays) de notre bien-être social et…du PIB.
Il faut donc bien financer ces dépenses pour préserver la croissance potentielle, ce qui n’est pas du tout pris en considération dans le raisonnement standard exposé au §1 ci-dessus.
En effet, au plan économique, les investissements en question sont soit vu comme improductifs (comme ceux relatifs à l’adaptation au changement climatique, à la préservation de la biodiversité, au maintien en l’état de la disponibilité des ressources – comme l’eau) soit comme peu rentables (comme la rénovation énergétique des bâtiments, sauf à faire croître massivement le prix de l’énergie, au moins dans sa composante carbone).
Ainsi, ces investissements ne peuvent être financés entièrement par la voie privée puisque ni les calculs de VAN ni les calculs de rendement financier ne permettront de les justifier. La période de vaches budgétaires maigres qui s’annonce aura de plus pour effet de réduire leur financement, même partiel via des subventions, par fonds publics.
4/ Changer de boussole : privilégier la productivité des ressources naturelles (énergie, matière, terre) sur la productivité du travail.
Les dépenses dites improductives le sont à l’aune du travail. Pendant des millénaires, la préoccupation de l’humanité a été la lutte contre la famine, formulée de manière frappante, même si un peu simpliste par Thomas Malthus. La démographie augmente de façon exponentielle alors que les ressources disponibles ne croissent que de manière linéaire. La productivité du travail semble être alors la seule solution pour vaincre cette fatalité. Il faut avoir en tête les gains fabuleux de productivité, chiffrés par l’économiste Jean Fourastié, pour saisir en profondeur ce que cela veut dire, et ne pas balayer d’un revers de la main ses progrès considérables. Pour autant, aujourd’hui la ressource rare n’est plus la main d’œuvre, même si l’affaiblissement de la démographie dans les pays développés et certains « émergents » comme la Chine pourrait nous ramener à ce type de problème dans quelques décennies.
Nous sommes face à des tensions croissantes sur les ressources naturelles, causes actuelles de l’inflation et sources prochaines de pénurie si nous n’y prenons pas garde. Il nous faut donc valoriser leur productivité ; l’agriculture de demain par exemple devra être écologiquement productive et intensive. Ceci veut dire que nous devons changer nos ratios : la numérateur sera toujours la production (de qualité si possible) mais les dénominateurs pertinents ne seront plus la main d’œuvre mais les surfaces au sol, l’énergie, les intrants (eau, engrais, pesticides).
Nous sommes aussi face à des excès d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants, ce qui revient à des tensions sur une ou plusieurs limites planétaires (dont la capacité de l’atmosphère et de la biosphère à réguler le climat et dont les ressources vivantes impactées par les pollutions et l’exploitation excessive).
Si les valeurs monétaires de ces ressources et « régulations » résultant du marché sont inadaptées, ces ratios ne seront pas de bonnes boussoles. Il faut donc une intervention publique pour ce faire. Et dans un premier temps cela peut passer par leur financement public, étant entendu qu’il est possible de faire des calculs de valeur économique, non marchand, pour aider le public à faire des arbitrages, sans pour autant que cela se traduise financièrement. Pour prendre l’exemple du carbone, l’État et les collectivités territoriales peuvent utiliser dans leur calcul socio-économique une valeur du carbone telle que calculée par des commissions ad hoc. Cela ne se traduira pas financièrement mais aidera les acteurs publics à orienter leurs dépenses.
5/ Ces dépenses ne peuvent être financées que par création monétaire publique.
Dans cette conjoncture, que Jézabel Couppey-Soubeyran et ses coauteurs appellent le « triangle infernal des finances publiques »[16], la seule solution pour que ces dépenses soient financées, c’est le recours à la création monétaire publique (sans dette à rembourser en contrepartie). C’est le seul moyen qui permette de financer des dépenses sans besoin de remboursement. Le bilan de la banque centrale pourrait être en théorie équilibré (avec à l’actif une dette perpétuelle ou quasi, comme l’ont proposé entre autres Daniel Cohen et Nicolas Théry dans une tribune au Monde[17]). S’il ne l’était pas (en supposant par exemple qu’il faille absolument amortir cette dette) peu importe fondamentalement[18] car une Banque centrale peut fonctionner avec des fonds propres négatifs, précisément parce qu’elle a le pouvoir de création monétaire, auquel les principales banques occidentales ont fait appel dans les opérations de Quantitative Easing[19] . Il y faut seulement bien sûr des limites et un cadre bien défini, du doigté et une bonne communication pour éviter tout risque de spéculation sur la valeur de l’euro en expliquant au marché que les opérations financées sont précisément faites pour rendre la zone Euro plus résiliente et, dans le langage économique habituel, de nature à combler l’output gap qui se creuserait sans ces dépenses.
Nous ne rentrerons pas ici dans la question des modalités qui permettraient de réaliser ce financement tout en restant dans le cadre des traités européens[20].
6/ Bien choisies et dimensionnées, ces dépenses ne sont pas nécessairement inflationnistes et peuvent s’accompagner d’une non-décroissance du PIB voire de sa croissance.
L’idée que la création de monnaie centrale (ou publique) par opposition à la monnaie scripturale créée par les banques commerciales est nécessairement inflationniste, n’est rien de plus qu’un dogme sans fondement dans sa généralité[21].
En un mot, elle repose d’une part sur l’opinion que la création de monnaie serait neutre : elle n’aurait donc aucun autre effet sur les quantités produites et ne se traduirait que par une hausse des prix. Elle repose d’autre part sur l’idée que les citoyens, connaissant et acceptant la validité de l’opinion précédente, anticiperaient donc cette hausse des prix attendue en épargnant annulant ainsi les effets de relance induits par un financement monétaire.
Dans les faits, ces deux assertions sont fausses : tant que les capacités de production ne sont pas saturées une commande publique crée de l’emploi et distribue des revenus qui seront eux-mêmes en partie redépensés (en investissements ou en consommation)[22]. Par ailleurs, dans la pratique, les citoyens n’anticipent pas ces supposés effets futurs.
Un raisonnement plus sophistiqué est parfois mis en avant : des anticipations inflationnistes auraient lieu sur les marchés financiers ce qui ferait croître les taux d’intérêt de long terme[23]. Dès lors, ce financement monétaire se traduirait in fine par une hausse du service de la dette publique, réduisant les marges de manœuvre supposées libérées par le financement monétaire. Là à nouveau l’argument n’est pas convaincant : l’appétit des marchés financiers pour la dette publique repose avant tout sur sa soutenabilité qui serait bien plus assurée par la réalisation des investissements publics envisagés que par l’attentisme et une soi-disant rigueur budgétaire aboutissant au chaos.
Dès lors on peut bien s’attendre à ce que des dépenses dites improductives ainsi financées soit source de croissance du PIB et dans tous les cas susceptibles d’en limiter la baisse, comme on l’a expliqué au paragraphe 3.
Alain Grandjean