Le cours de Nicholas Stern au Collège de France « Gérer les changements climatiques, promouvoir la croissance, le développement et l’équité » a été clôturé les 7 et 8 juin derniers par une conférence internationale co-organisée par Roger Guesnerie focalisant la réflexion sur deux points cruciaux du changement climatique : l’économie du long terme et la promotion de l’innovation.
Cette initiative heureuse était le débouché naturel et attendu de l’enseignement de Nicholas Stern où celui-ci avait présenté une vision panoramique et pragmatique de ces problèmes dans leur configuration physique, économique et politique. Ces leçons, au nombre de six, n’ont pas fait appel à des modèles économiques sophistiqués où les phénomènes sociaux sont « expliqués » par des boîtes noires mathématiques. Il s’agissait au contraire d’une présentation géopolitique des divers points de vue et arguments en présence dans les discussions entre les acteurs Etats, experts, public. Dans cette synthèse aux assises nécessairement incertaines et contestées, le rôle accordé par Stern à l’économie était minimal. On peut dire que c’est l’art de retenir les faits simples, quantifiés, importants qui structurent le paysage décisionnel.
Pour autant l’auteur de la Stern review n’en est pas resté à des généralités. Son analyse, précautionneuse, conduisit progressivement l’auditoire devant des thèses claires et fortes. Un de leurs points saillants est que pour penser l’avenir et sortir de l’impasse des intérêts divergents il convient que les pays riches régulent leurs émissions et en outre participent au financement d’une réorientation moins polluante de l’économie des pays en développement, position proche de celle à laquelle arrivait la Banque Mondiale dans son rapport diffusé avant Copenhague, et qui semble, en effet, la seule réaliste devant cet immense problème dont la caractéristique principale actuelle est l’immobilisme1.
Cette lecture de la problématique pose immédiatement la question du financement à long terme, car pendant que les uns et les autres, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, etc., se querellent pour esquiver les efforts, c’est l’équité intergénérationnelle qui bascule : l’ordre économique contemporain confond avantage compétitif et avantage immédiat, pour des raisons profondes qui tiennent au fonctionnement même du système libéral fondées non seulement sur une certaine confiance dans le progrès technique qui fait penser que les entreprises actuellement les plus performantes seront aussi celles les mieux à même de profiter des innovations mais aussi de plus en plus sur l’idée inverse qu’en situation de difficulté elles seront celles qui résisteront le mieux. Cette myopie se traduit par des taux d’actualisation trop élevés pour que les choix de « gestion rationnelle » prennent en compte le long terme et engagent des investissements nécessaires à un cadre de vie acceptable pour les générations futures. Beaucoup d’économistes sont conscients de cette situation et un courant se dégage parmi eux qui réclame à être mieux entendu des pouvoirs publics et des dirigeants afin de quitter la passivité irresponsable du business as usual. Au demeurant l’actualité ne porte pas à l’optimisme en la matière puisque les ministres des finances du G20 réunis à Busan en Corée du Sud la semaine dernière ne sont pas parvenus à s’entendre sur le principe d’une taxe bancaire internationale, échec qui, après Copenhague, porte un coup sérieux à la recherche de « financements innovants » (préconisés notamment par Jean-Louis Borloo) dont l’idée semblait faire consensus en France, avec cette réserve évidente qu’elle ne pouvait être décidée unilatéralement.
Dans ce contexte, les attentes de ce colloque au Collège de France dépassaient les enjeux habituels des rencontres académiques. Le projecteur était mis sur un sujet crucial autour duquel s’entremêlent les contradictions où se débat notre époque que les économistes allaient s’efforcer d’élucider raisonnablement pour qu’on y voie plus clair.
La première surprise fut pour moi le choix des intervenants où figure bon nombre de ténors de l’économie néoclassique, ainsi appelée pour qualifier l’orientation prise par le libéralisme dans les années 1980 marquée par une dominance et une complexification des marchés financiers. Je ne discuterai ici que certains points d’intervenants très célèbres, parce qu’ils marquent, par leur notoriété même, plus typiquement les préoccupations de la communauté économique. L’exposé de M. L. Weitzman (Harvard) a essentiellement porté sur les incertitudes, en insistant sur le fait que la mauvaise connaissance des probabilités des événements rares phénomène désigné sous le terme de « queues de lois épaisses » joint au fait que les dommages correspondants peuvent être extrêmes font que « l’exposition » au risque peut être illimitée. Il en déduit que l’analyse coût bénéfice appliquée au changement climatique peut être largement dominée par un facteur de crainte qui est au-delà des modélisations robustes. Au premier degré on ne peut que souscrire aux observations de Weitzman d’ailleurs connues depuis longtemps. Seulement ce qui laisse perplexe c’est pourquoi au point où nous en sommes de la négociation climatique ce professeur de Harvard tient-il ce type de discours ? Pourquoi insiste-t-il sur le doute et plaide-t-il ainsi, qu’on le veuille ou non, pour le business as usual ? (cf. à ce propos le remarquable ouvrage Doubt is their product de David Michaels). W. Nordhaus (Yale) va dans le même sens en poussant plus loin le propos grâce à de véritables statistiques sur les événements graves, tremblements de terre, désastres dus aux guerres, aux inondations, famines, etc. Le problème est que les statisticiens savent bien qu’il n’est pas raisonnable d’évaluer les queues de probabilités sur des événements mesurés avec des échelles qui ne sont pas des grandeurs additives. On ne peut additionner les points de l’échelle de Richter, cela n’a aucun sens. Les extrapolations qu’on ferait ainsi seraient aussi arbitraires que le repérage utilisé. De sorte que la seule grandeur additive qui est derrière tout ça c’est l’argent. Autrement dit une inondation au Bengladesh comptera pour peu de chose. Les économistes ne peuvent réfréner leur propension à tout évaluer en argent, tout ce qui se vend et tout ce qui ne se vend pas. Ce faisant évidemment ils n’obtiennent d’information que sur le passé ou le présent et la question du taux d’actualisation et de l’équité intergénérationnelle reste entière.
Pour résumer sur les queues de lois avant de passer à d’autres orateurs, soulignons que non seulement les queues de lois sont mal connues mais elles sont largement de nature interprétative relevant de lectures diverses de la réalité économique et politique. Cournot au 19ème siècle, en introduisant la notion de « probabilités philosophiques » avait déjà insisté sur le fait que la force des interprétations n’était pas quantifiable et ne relevait pas du calcul mathématique des probabilités. Il s’agit donc d’une limitation intrinsèque du langage économique lui-même. Il serait plus sage que les économistes le reconnaissent et laissent une vraie place à la décision politique.
Je citerai encore R. Guesnerie qui a présenté un travail conjoint sur le thème du taux d’actualisation au titre prometteur Intuition écologique versus « raison » économique. Mais hélas, la façon d’aborder cette intéressante question relève d’un véritable rituel à mon avis de moins en moins convaincant. Il s’agit d’un raisonnement à partir d’un modèle mathématique soi-disant simple mais couvrant néanmoins plusieurs pages de calculs dont le cœur est une fonction d’utilité entre un bien privé et un bien représentant l’environnement fonction dite CES (constant elasticity substitution) de sorte que les conclusions de la réflexion sur la pertinence de l’intuition écologique repose sur la valeur d’un exposant dans une formule et de la concavité ou convexité d’une fonction. Cette argumentation n’est-elle pas dérisoire devant le champ de bataille désolé que l’on risque de laisser à nos petits enfants. Quelle est cette « raison » économique mise ici à l’épreuve ? On nous ressert toujours ces petits modèles mathématiques pour aborder les questions du comportement des humains et de l’organisation sociale. Quelle est la relation véritable de ce type de discours avec la réalité ?
Passons sur plusieurs autres exposés encore fondés sur ces petits diagrammes faits de droites décalées ou de courbes concaves ou convexes censées expliquer les lois ou les tendances qui sont des raisonnements locaux où l’on raisonne en faisant varier infinitésimalement des grandeurs très abstraites et mal mesurées. Est-ce avec ça que l’on va éclairer le long terme ?
Finalement les économistes n’ont guère apporté de réponse à cette grande question qu’est le financement du long terme et le choix d’un taux d’actualisation. Ce dont ils ont fourni la preuve en revanche, c’est que les conventions du langage économique (disons : petits schémas mathématisés fondés sur la quête d’équilibres tels qu’en a décrit la littérature théorique) obèrent sérieusement une pensée pertinente sur une telle question. La conclusion raisonnable devrait être dès lors que l’économie ne doit pas à toute force chercher à étendre son royaume mais laisser la place à la négociation politique pluraliste au sein d’instance internationales renforcées.
Mais la conclusion de fait n’est pas celle-là. C’est que le taux d’actualisation en tant qu’outil pour la décision publique et la politique incitative est une vue de l’esprit : les taux sont donnés par les marchés financiers et s’imposent aussi bien aux entreprises qu’aux Etats. Ne pas en tenir compte en proposant des obligations peu rémunérées est irréaliste. Les marchés à terme et les dérivés de crédit annihilent la position particulière qu’avait l’Etat vis-à-vis de ses administrés dans le passé.
Je dois signaler cependant l’intervention de C. Hepburn (Oxford) qui sortait de ces byzantinismes et pointait lucidement les limites de la modélisation économique. Il m’a semblé au cours de ses interventions que Nicholas Stern n’était pas loin de souscrire à cette analyse mais comme il l’a dit, il considère indispensable de garder le langage économique pour se faire comprendre. Il y a sans doute une part de sagesse dans cette affirmation, à condition que le langage économique ne défende pas toujours les mêmes thèses.
Nicolas Bouleau
Chercheur au CIRED
1 Immobilisme qui signifie toujours autant de carbone rejeté dans l’atmosphère donc par effet de stock aggravation.


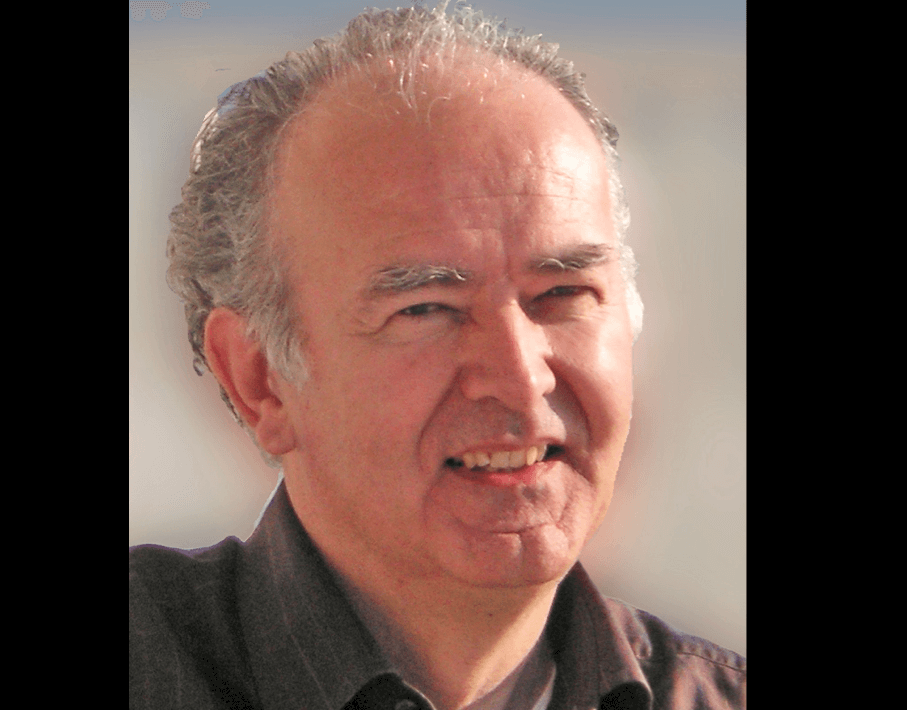
3 réponses à “Financement du long terme (Billet invité : Nicolas Bouleau)”
Comparaison n’est pas raison…
Les économistes sont aussi parfois des mathematiciens… Pour ceux qui ne le sont pas, il peut arriver que… » les petits diagrammes faits de droites décalées ou de courbes concaves ou convexes censées expliquer les lois ou les tendances »… et d’autres outils des… « sciences inhumaines », (comme disait le regretté Gérard Mégie), exercent une véritable fascination… sur des esprits aussi distingués que celui de Mr R. Guesnerie !
Je suis toujours un peu derouté lorsque des intérêts vitaux sont en jeu… et que l’on tente de me convaincre de la fatalité, (ou au contraire, du sursaut salvateur qui s’annonce), en mettant en évidence une propriété mathématique… dont le lien avec la realité humaine et sociale n’est ni vraiment établi, ni tres convaincant.
Je suis à la fois assez anti-Stern et assez d’accord avec le post !
1- ce qui a fait la célébrité du rapport Stern est qu’il a voulu apporter une froide démonstration économiciste à la necessité d’investir massivement sur la question climatique. Le problème est que, dans la mécanique froide de la science éco, sa projection ne tient pas notamment à cause du taux d’actualisation. on pourrait en discuter des centaines d’heures mais bon je pense que les arguments de Weizman, Nordhaus et Dasgupta sont très pertinents. Sans y parvenir complètement, Stern cherche alors à justifier ses choix méthodos en mobilisant des arguments qui ne rélèvent pas de la science éco (l’éthique ou tout simplement l’enjeu écologique par exemple). en soi, il faut absolument le faire. Mais le problème est que plus on tire plus ce qui fait la valeur ajoutée du rapport Stern (sa froide démonstation économique) se dilapide. En résumé j’ai plusieurs points de désaccord avec Grandjean/Janco mais je préfère cette approche à celle de Stern.
2°) Une des hypothèses sterniste sur le taux d’actualisation, si on la combine à la notion de coût d’opportunité, renvoie à un lourd problème de choix politique. Stern ne veut pas tenir compte du fait que très probablement, même avec un changement climatique difficile, de nombreuses populations seront moins pauvres dans 100 ans qu’ajourd’hui (là je vais faire hurler…) ce qui change la manière de percevoir l’équité intergénérationelle. Disons le autrement : le premier ministre indien fait aujoud’hui face à de grave problème de santé publique, d’éducation, de pauvreté etc et suppose, probablement à raison, que ses problèmes seront moins prononcées dans 100 ans. Du coup, dans un univers de rareté des moyens, il doit essayer de maintenir un équilibre entre l’investissement sur de graves problemes actuels et l’investissement de plus long terme sur le climat et, ici, l’équité intergénérationnelle impose de ne pas trop délaisser les problèmes actuels . La dessus Stern passe à coté.
F Carlier
[…] du taux d’actualisation, ni plus globalement de la pertinence et des limites de l’ACB, que Nicolas Bouleau a discuté dans ce blog, mais de la manière dont sont comptabilisés les coûts et les […]