« La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. » Albert Einstein. Même si l’on peut constater des progrès dans la perception de l’ampleur de la crise écologique et notamment du changement climatique, notamment grâce à l’accord de Paris, force est de constater que nous sommes loin du compte. Face à la « grande accélération » de cette crise dont les indicateurs principaux montrent les phénomènes exponentiels sous-jacents, il nous faudrait accélérer puissamment nos réponses et nous ne le faisons pas. Pourquoi ? Parce que le « logiciel » dominant n’intègre pas cette notion en son cœur, et parce que notre boussole (la croissance du PIB pour l’Etat et le profit tel que calculé aujourd’hui par et pour les entreprises) nous fait aller à contre-sens.
Le logiciel dominant et ses défaillances
Le logiciel dominant est simple à exprimer : la croissance du PIB (souvent confondue avec celle de la richesse nationale[1]) permettrait d’augmenter l’emploi[2], le pouvoir d’achat, notre capacité d’investissement et d’innovation, conditions nécessaires d’une part pour une amélioration du bien-être ou du bien-vivre collectif, et, d’autre part pour la résolution des problèmes écologiques, que science, technique et ingéniosité humaine sauront résoudre. Les « fruits de la croissance » permettraient en outre de rembourser les dettes publiques et privées contractées pour la rendre possible. Les politiques économique et monétaire, devraient donc « libérer » la croissance[3], en agissant sur l’offre[4], l’action sur la demande étant inefficace dans un contexte d’intense compétition internationale. En termes plus techniques, elles devraient viser à combler l’« output gap », écart entre la croissance constatée et la croissance potentielle[5]. C’est ainsi que sont justifiées « l’allègement » du droit du travail, la suppression des « rentes de situation », la simplification administrative, la réduction des dépenses publiques (qui pèsent sur les charges des entreprises et nuisent à leur compétitivité) etc. Bref, ce qui est au centre les programmes économiques de nos dirigeants et des réformes proposées ou imposées depuis « le tournant de la rigueur » en 1983.
La croissance du PIB est dont à la fois le guide suprême et le juge de paix de l’efficacité des politiques économiques.

Pourtant, on sait que la croissance du PIB est un mauvais indicateur pour presque tous les critères évoqués dans le raisonnement ci-dessus.
On peut facilement constater qu’elle n’est en rien une condition suffisante pour l’atteinte des objectifs évoqués (création d’emploi, distribution de pouvoir d’achat, désendettement etc.).
La littérature sur le sujet étant abondante[6], je me limiterai ici à un résumé rapide.
D’une part, la construction du PIB pose plusieurs problèmes :
- il n’intègre que très partiellement le travail non-marchand, dont le volume est massif ;
- l’effet qualité (qui permet de séparer l’effet prix de l’effet volume) est difficile à évaluer ;
- il est survalorisé puisqu’il ne tient pas compte de la dépréciation du capital ;
- enfin la hausse (purement spéculative) de l’immobilier conduit à surévaluer le PIB.
D’autre part, la croissance du PIB n’est pas (ou plus) systématiquement corrélée :
- à la création d’emplois[7] ;
- à la réduction de la pauvreté et des inégalités ;
- à l’amélioration du pouvoir d’achat (cela dépend bien évidemment des catégories sociales !) ;
- à l’amélioration de la santé et à la hausse de l’espérance de vie en bonne santé ;
- au désendettement.

Inversement, cette croissance est très bien corrélée à la consommation d’énergie, aux émissions de GES et plus généralement à la pollution et à la destruction de la nature (au point que c’est probablement le meilleur indicateur de cette destruction). Elle ne garantit pas aux sociétés humaines d’être résilientes aux « chocs » – comme l’a montré la crise de 1929 et dans un autre registre la triste histoire de l’île dévastée Nauru.
Comme le dit Eloi Laurent :
« Le PIB est trompeur quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain et muet sur la soutenabilité écologique. La croyance dans la croissance est soit une illusion soit une mystification. ».
La croissance du PIB est-elle une condition nécessaire pour l’atteinte des objectifs évoqués ci-dessus (création d’emploi, distribution de pouvoir d’achat, désendettement, …) ? L’histoire du dernier siècle a certes montré que les récessions n’étaient en général pas socialement bénéfiques (qu’on pense à la crise de 1929, à la décennie perdue en Amérique du Sud, ou plus près de nous à la descente aux enfers de la Grèce). Pourtant, il va bien falloir faire avec un taux de croissance faible à très faible, comme le montre la baisse continue du taux de croissance du PIB dans les pays développés[8]. Par ailleurs, si l’on n’arrive pas à découpler croissance du PIB et « consommation de nature » [9], la seule solution pour préserver un environnement viable pour les êtres humains sera bien la stagnation du PIB voire sa décroissance.
Intégrer les objectifs de durabilité dans le processus budgétaire
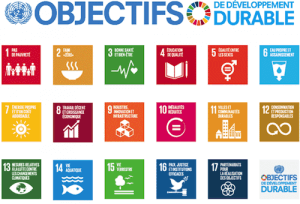
En 2015, la communauté internationale a adopté 17 objectifs de développement durables et la France une loi (la loi SAS) imposant que le gouvernement fasse un rapport annuel relatif au suivi d’indicateurs complémentaires au PIB.
Ces initiatives semblent à ce jour sans effet concret. Pourquoi ?
Selon Antonin Pottier[10], ce serait pour quatre raisons :
- depuis le tournant néolibéral des années 1980, les gouvernements ont perdu la main sur le destin économique des nations ; les indicateurs comme le PIB sont donc plus des résultantes de choix individuels que des instruments de pilotage. La croissance du PIB est donc essentiellement l’effet agrégé des actions des entreprises et des ménages – qui souhaitent en règle générale voir augmenter leurs revenus (dont la résultante est le PIB) ;
- les hommes politiques voient dans le PIB un indicateur de puissance et d’influence, motivation majeure pour la plupart d’entre eux ;
- la croissance du PIB est facteur de réduction du chômage ;
- enfin, il est sceptique quant à l’influence potentielle des indicateurs alternatifs au PIB.
Il me semble qu’il sous-estime l’intérêt d’un débat public et notamment parlementaire sur les objectifs poursuivis par le gouvernement et leur traduction en indicateurs concrets, parlant aux citoyens. De plus, s’il est vrai que les gouvernements ont perdu la main sur de nombreux outils économiques, il leur reste malgré tout des marges de manœuvre sur les inégalités sociales, l’emploi[11] et les impacts écologiques de l’activité économique dans leur pays.
Antonin Pottier soulève, cependant, un point essentiel : à ce jour, la plupart des efforts des promoteurs des nouveaux indicateurs se sont concentrés sur la définition et le processus de choix de ces indicateurs et pas assez sur la façon de les rendre véritablement opérationnels. Comme il l’écrit : « Beaucoup de temps a été consacré à la discussion de la définition des indicateurs et de leur nature démocratique, du processus d’adoption par les experts ou les citoyens, pas assez aux institutions requises pour que les nouveaux indicateurs transforment véritablement la réalité« .
Une première voie pour remédier à cela est identifiée par Eloi Laurent[12] qui propose que les choix budgétaires faits lors du vote des lois de finances soient éclairés par une série d’informations synthétiques[13] relatives à l’état de la Nation et ses progrès dans trois dimensions :
- l’évolution des inégalités sociales ;
- l’entretien du patrimoine national (tant en termes de soutenabilité que de résilience, notamment au changement climatique) ;
- et la place du pays dans le monde- notamment son impact écologique global.
Dans cette optique le déficit et la dette publics et le PIB ne sont considérés que comme des objectifs intermédiaires.

Pour avancer dans la construction et le suivi d’un tel tableau de bord et son intégration dans le processus budgétaire, il est nécessaire de la confier à une instance collégiale indépendante (comprenant, comme le propose Eloi Laurent, parlementaires, experts et citoyens). Elle serait chargée de rédiger le rapport relatif aux objectifs et indicateurs retenus (afin d’éviter l’inévitable plaidoyer pro-domo d’un rapport gouvernemental).
Il serait ensuite souhaitable que le gouvernement en fasse le cœur de sa communication économique, au lieu de ne se positionner que par rapport à l’évolution du PIB, quelle qu’elle soit.
Il est tentant de faire ici un parallèle avec le rapport d’activité des entreprises. Il est de plus en plus clair et partagé que les données comptables et financières ne constituent qu’un angle de vue, certes important pour les actionnaires et les prêteurs et pour caractériser la solvabilité de l’entreprise et ses éventuels risques financiers. Mais certainement très insuffisant pour apprécier la qualité de la stratégie, et encore plus pour la construire, dans un monde de plus en plus incertain et interdépendant. En particulier, le « profit » (ou résultat net) ne peut être ni la finalité d’une entreprise ni l’indicateur unique de sa performance (même étroitement économique, mais encore moins sociale et environnementale).
Pour donner une image plus complète et juste de l’entreprise, les dirigeants produisent des « rapports intégrés », visant à rendre compte et projeter des indicateurs financiers et extra-financiers en lieu et place des seules données comptables et financières.
De la même manière un gouvernement « moderne » aux yeux ouverts sur les réalités et les risques de notre temps doit gouverner le pays avec un tableau de bord présenté et approprié comme un véritable outil de pilotage. Qu’attend le gouvernement actuel, dont le Président est devenu « l’ami du climat » pour se lancer dans cette aventure ?
Alain Grandjean


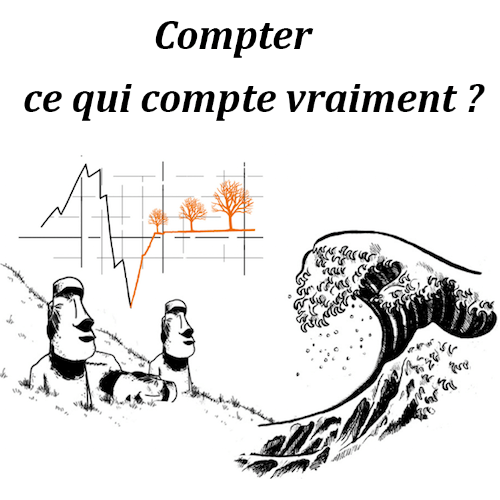
5 réponses à “Pour accélérer la transition écologique il faut changer de logiciel et de boussole”
Bonjour Alain,
Tu rappelles avec raison que, jusqu’à maintenant, » les récessions n’étaient en général pas socialement bénéfiques ».
Qu’est-ce qui a changé, et qui te permet de penser qu’on pourrait avoir des « récessions heureuses » ?
Pour fixer les idées, si on prend les hypothèses d’un scénario negaWatt, qui requiert une baisse de presque 4% par an de l’énergie primaire, et en supposant que l’intensité énergétique du PIB s’améliore de 1,5% par an (ce qui me semble optimiste), alors l’égalité de Kaya indique que le PIB va baisser d’environ 2,5% par an, pendant 20 ans. C’est une récession considérable! Comment faire en sorte qu’elle soit « socialement bénéfiques », alors que dans le passé de telles récessions ne l’ont pas été, bien au contraire ?
Note que changer d’indicateur ne changerait rien – même si on en crée qui augmentent en prenant des mesures écologiques, il va nous falloir apprendre à vivre avec des PIB en baisse, donc en récession. Le définition de nouveaux indicateurs me semble donc secondaire, par rapport au problème de l’acceptabilité par les citoyens d’un tel changement de logiciel.
Bien à toi, Thierry
bonjour Thierry, pas sur qu’on se comprenne bien, je suis bien d’accord que changer de thermomètre ne change pas la température certes, si c’est cela que tu veux dire. Mais ca c’est de la physique,là on est dans le domaine social, des représentations et de l’imaginaire; la baisse d’un indicateur dans ce domaine est un sujet important s’il est considéré comme central dans la politique menée et pour les habitants. Mais si l’on prend au sérieux les critiques du PIB on en déduit que sa variation n’a en fait pas l’importance qu’on lui donne; dès lors la vraie question est bien celle de l’évolution d’autres indicateurs représentant mieux ce qu’on vise à représenter. donc il faut préciser ce qui acceptable ou pas par nos concitoyens. j’ essaie de montrer que les baisses ou les hausses actuelles du PIB ne sont pas nect corrélées avec des indicateurs de ce genre (comme l’emploi, qui est sans doute le plus sensible mais aussi la repartition du pouvoir d’achat). et je suis vraiment convaincu que si le pouvoir politique s’empare vraiment de ces nouveaux indicateurs, s’engage dessus et se les approprie il contribue à l’acceptabilité du nouveau logiciel; ce qui est l’angle de l’article.
Par ailleurs l’effet d’une « recession » c’est-à-dire d’une baisse de PIB dépend à mes yeux du niveau de PIB ou on se situe, de la manière dont on la gère et dont la communique (la question étant celle du scénario de référence/ on s’explique).les précédents historiques ne me semblent pas devoir être pris comme une preuve de l’impossibilité de gerer une baisse du PIB . j’insiste un peu : toute la question est de savoir si l’on peut faire progresser ou maintenir d’autres indicateurs. Prenons un exemple concret : si je dois attendre un peu plus pour disposer d’un objet que je désire ( un des effets possibles d’une gestion plus sobre des transports de marchandises) est ce forcément et toujours une source de frustration? si je dois manger moins de viande idem? Nos travaux actuels sur un scénario ZEN 2050 pour EPE, semblent montrer que cela va dépendre des profils des personnes concernées; mais qu’il n’est pas sur que la majorité (aujourd’hui hésitante, pas engagée mais pas non plus « résistante » à ne puisse bouger,
Bien à toi. Alain
Bonjour Alain,
Merci pour tes posts toujours utiles.
Dans la lignée du commentaire de Thierry Caminel, il me semble que notre principal problème est un problème de représentation, d’imaginaire collectif.
On ne peut plus ignorer que limiter la hausse moyennes des températures à 2°C voire 1,5°C nécessite un changement radical de mode de vie, de « way of life » qui implique notamment une baisse drastique du PIB du fait de sa corrélation avec l’énergie fossile mais également avec les matières premières non énergétiques qui emportent avec elle les mêmes contraintes de finitudes et d’impact sur l’environnement global de la Terre.
Dans ce contexte, effectivement, vivre dans un monde « max +1,5°C dans le temps » (sachant que l’on est déjà à 1,1°C que les hausses d’émissions de CO2 s’accélère) nécessite de diminuer par 5, 6, 10 voire plus son empreinte écologique et donc son niveau de consommation (en bien, voyage et services). Cela se traduit par un mode de vie dont certain parle pour l’instant d’une façon trop métaphorique : « la sobriété heureuse »… Julien Wosnitza a eu une image assez parlante pour décrire la différence entre notre mode de vie et le mode de vie qu’il faudrait avoir : c’est la différence entre le mode de vie d’un parisien et d’un zadiste à NDDL. Je ne sais pas si l’image est bonne, mais elle a le mérite d’être clair.
A l’inverse, on défend trop souvent du rêve avec une société hyper-connecté, bourré d’ENR, de VE, de Big data, le tout orchestré par une IA au sourire angélique… C’est UTOPIA dans toute sa splendeur. Même le film « Demain » reste loin de la réalité et ne correspond qu’à une adaptation de notre modèle et non un changement de paradigme.
Ce qui manque fondamentalement, c’est la description claire, tangible du « Accord de Paris Way of Life », si je puis m’exprimer ainsi. Je ne dis pas que cela permettra de faire changer tout de suite, mais au moins cela permet de poser une vision claire, de montrer clairement le logiciel que nous devons adopter et montrer qu’il ne fait pas peur. La décroissance est trop perçu comme un remix de « Apocalypse now » et forcément, la réaction normal est le déni face à la réalité pour s’accrocher à son cocon. Je ne dis pas que cela résoud le problème de l’acceptation, mais en tout cas, cela me semble un premier pas nécessaire.
Un autre point par rapport aux politiques qui n’aborde pas du tout la problématique du changement de paradigme, ce serait d’organiser un grand débat sur cette question en prenant comme point de départ le rapport Meadows et sa justification par 40 années d’adéquation avec la réalité de notre monde. Car tant que les politiques ne mettent pas des mots clair, une vision clair sur ce que Meadows implique, sur ce que l’Accord de Paris implique, on reste dans le pure marketing qui vend du rêve pour masquer la catastrophe.
Au plaisir d’échanger et encore merci pour ton blog !
Bien à toi,
Nicolas
hello Nicolas, merci pour ton commentaire avec lequle je suis bien d’accord, il faut qu’on arrive à faire sentir à quoi ce monde peut ressembler, du coup j’en profite pour préciser que l’insistance de certains à documenter le caractère inéluctable d’un effondrement (chronique d’une mort annoncée) ne me semble pas la bonne voie aujourd’hui; c’est d’ailleurs le symétrique de la vision quasi trans-humaniste portée par les technophiles; il serait beaucoup plus utile de c construire des scénarios avec des « pertes » (comme pouvoir disposer de tout tout de suite, ou de manger de la viande ou du fromage à toute heure) mais des gains (plus de liens moins de biens); je pense aussi qu’il y a une grande diversité sociologique à intégrer dans l’histoire ; à bientôt; bien à toi . Alain
[…] « La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. » Albert Einstein. Même si l’on peut constater des progrès dans la perception de l’ampleur de la crise écologique et notamment du changement climatique, notamment grâce à l’accord de Paris, force est de constater que nous sommes loin du compte… lire […]